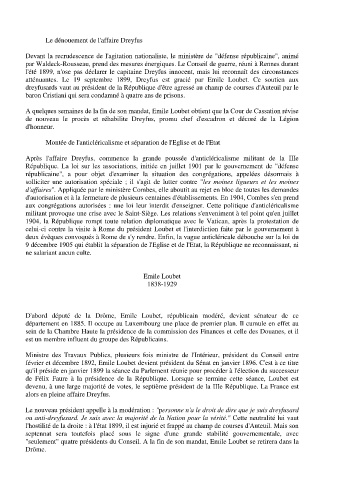Page 281 - Tous les bulletins de l'association des" Amis du Vieux Marsanne"
P. 281
Le dénouement de l'affaire Dreyfus
Devant la recrudescence de l'agitation nationaliste, le ministère de "défense républicaine", animé
par Waldeck-Rousseau, prend des mesures énergiques. Le Conseil de guerre, réuni à Rennes durant
l'été 1899, n'ose pas déclarer le capitaine Dreyfus innocent, mais lui reconnaît des circonstances
atténuantes. Le 19 septembre 1899, Dreyfus est gracié par Emile Loubet. Ce soutien aux
dreyfusards vaut au président de la République d'être agressé au champ de courses d'Auteuil par le
baron Cristiani qui sera condamné à quatre ans de prisons.
A quelques semaines de la fin de son mandat, Emile Loubet obtient que la Cour de Cassation révise
de nouveau le procès et réhabilite Dreyfus, promu chef d'escadron et décoré de la Légion
d'honneur.
Montée de l'anticléricalisme et séparation de l'Eglise et de l'Etat
Après l'affaire Dreyfus, commence la grande poussée d'anticléricalisme militant de la IIIe
République. La loi sur les associations, initiée en juillet 1901 par le gouvernement de "défense
républicaine", a pour objet d'examiner la situation des congrégations, appelées désormais à
solliciter une autorisation spéciale ; il s'agit de lutter contre "les moines ligueurs et les moines
d'affaires". Appliquée par le ministère Combes, elle aboutit au rejet en bloc de toutes les demandes
d'autorisation et à la fermeture de plusieurs centaines d'établissements. En 1904, Combes s'en prend
aux congrégations autorisées : une loi leur interdit d'enseigner. Cette politique d'anticléricalisme
militant provoque une crise avec le Saint-Siège. Les relations s'enveniment à tel point qu'en juillet
1904, la République rompt toute relation diplomatique avec le Vatican, après la protestation de
celui-ci contre la visite à Rome du président Loubet et l'interdiction faite par le gouvernement à
deux évêques convoqués à Rome de s'y rendre. Enfin, la vague anticléricale débouche sur la loi du
9 décembre 1905 qui établit la séparation de l'Eglise et de l'Etat, la République ne reconnaissant, ni
ne salariant aucun culte.
Emile Loubet
1838-1929
D'abord député de la Drôme, Emile Loubet, républicain modéré, devient sénateur de ce
département en 1885. Il occupe au Luxembourg une place de premier plan. Il cumule en effet au
sein de la Chambre Haute la présidence de la commission des Finances et celle des Douanes, et il
est un membre influent du groupe des Républicains.
Ministre des Travaux Publics, plusieurs fois ministre de l'Intérieur, président du Conseil entre
février et décembre 1892, Emile Loubet devient président du Sénat en janvier 1896. C'est à ce titre
qu'il préside en janvier 1899 la séance du Parlement réunie pour procéder à l'élection du successeur
de Félix Faure à la présidence de la République. Lorsque se termine cette séance, Loubet est
devenu, à une large majorité de votes, le septième président de la IIIe République. La France est
alors en pleine affaire Dreyfus.
Le nouveau président appelle à la modération : "personne n'a le droit de dire que je suis dreyfusard
ou anti-dreyfusard. Je suis avec la majorité de la Nation pour la vérité." Cette neutralité lui vaut
l'hostilité de la droite : à l'état 1899, il est injurié et frappé au champ de courses d'Auteuil. Mais son
septennat sera toutefois placé sous le signe d'une grande stabilité gouvernementale, avec
"seulement" quatre présidents du Conseil. A la fin de son mandat, Emile Loubet se retirera dans la
Drôme.